NGAP et soins post-opératoires : maîtriser la cotation infirmière
Orion Santé
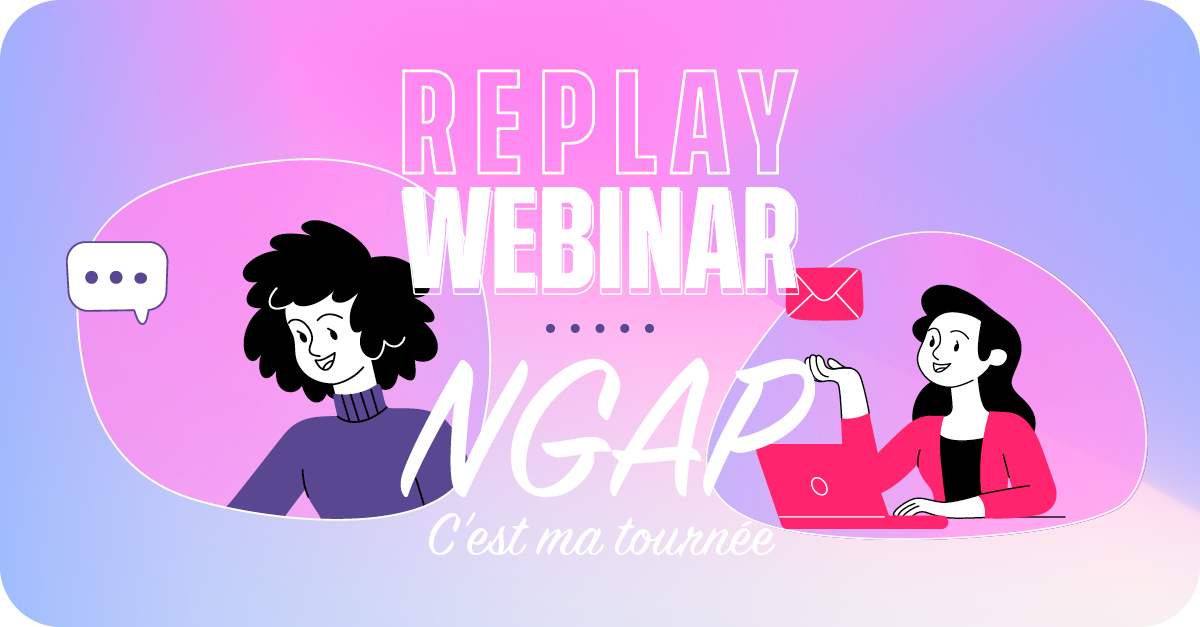
La prise en charge des patients après une intervention chirurgicale fait partie du quotidien des infirmiers libéraux. Pourtant, la cotation des soins post-opératoires selon la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) reste une source de doutes, d’erreurs fréquentes et parfois de litiges. Dans cette vidéo, [nom de l’intervenant] décrypte pas à pas les règles essentielles pour appliquer correctement la NGAP, sécuriser sa facturation et rester conforme à la réglementation.
Pourquoi la NGAP est cruciale en post-opératoire ?
La NGAP fixe le cadre légal et financier des soins infirmiers réalisés à domicile. Pour les patients opérés, elle permet :
- D’assurer une traçabilité des soins (pansements, injections, surveillance post-opératoire).
- De garantir une juste rémunération de l’IDEL.
- De sécuriser la relation avec l’Assurance Maladie et d’éviter les indus.
⚠️ Beaucoup d’IDEL commettent encore des erreurs de cotation sur les soins post-opératoires : oublis de majorations, cumuls interdits, ou confusion entre actes techniques et actes de surveillance.
Les fondamentaux à retenir
La vidéo revient sur les règles clés de la NGAP en post-opératoire :
- Actes concernés : pansements simples ou complexes, ablation de fils ou d’agrafes, injections prescrites, surveillance clinique.
- Cotation correcte : distinction entre AIS, AMI et AMX selon le type d’acte.
- Majoration spécifique : par exemple, la MCI (Majoration Coordination Infirmière) ou la MIE (Majoration Enfant) si les conditions sont réunies.
- Durée et fréquence : bien préciser la prescription médicale et s’assurer de la cohérence des passages.
Méthode pas-à-pas pour coter un soin post-opératoire
- Analyser l’ordonnance : nature du soin, durée prévue, contexte du patient.
- Identifier l’acte dans la NGAP : choisir la bonne rubrique (pansement, injection, surveillance).
- Vérifier les règles de cumul : un pansement complexe ne se cumule pas toujours avec une injection, sauf exceptions.
- Appliquer les majorations : zone rurale, enfant, coordination… selon les cas.
- Tracer et sécuriser : noter les soins, archiver l’ordonnance, conserver une preuve pour éviter les indus.
Cas pratiques expliqués dans la vidéo
- Patient opéré avec pansement complexe + injection quotidienne → cotation AMI spécifique + vérification des règles de cumul.
- Ablation de fils après chirurgie mineure → cotation d’un pansement simple, sans surcotation.
- Patient fragile nécessitant une surveillance rapprochée → possibilité d’intégrer la notion de surveillance clinique en NGAP, avec la cotation adaptée.
Ces exemples permettent de passer de la théorie à la pratique et de repérer les erreurs les plus fréquentes.
À retenir en 5 points
- Toujours partir de l’ordonnance et de la prescription médicale.
- Identifier la bonne rubrique dans la NGAP (AMI, AIS, AMX).
- Vérifier les règles de cumul avant de facturer.
- Appliquer les majorations possibles quand les conditions sont remplies.
- Tracer et sécuriser chaque acte pour prévenir les indus.
Pourquoi cette vidéo est essentielle pour les IDEL ?
- Sécurité juridique et financière : éviter les erreurs de facturation.
- Gain de temps : méthode claire et directement applicable.
- Amélioration de la qualité des soins : cohérence entre prescription et pratique.